L'autre Michel-Ange
Il faudra que j'aille à Ferrare un jour. Je le savais depuis longtemps déjà, vous connaissez ma passion pour l'Italie en général, sa litté et son ciné en particulier. J'ai décidé de dire litté comme on dit ciné, à savoir une belle apocope, histoire d'avoir l'air de frayer avec tout ce qui s'écrit et se lit. Vanité...Humour, ça je précise toujours. Faute d'aller en Emilie-Romagne je me suis contenté pour l'instant de visiter à la Cinémathèque de Bercy, curieux endroit ou snobisme et perdition voisinent avec nostalgie et fascination, l'expo (encore une apocope) consacrée à Michelangelo Antonioni, un beau et patricien patronyme, presque aussi beau qu'Edualc Eeguab. C'est un modèle pour les cinéphiles, un endroit où je me suis senti mal, donc en phase avec le cinéma d'Antonioni, où tous les personnages ne vont pas bien, donc j'étais bien là bas à Bercy, à ma place, pas aux Finances. Le cinéma antonionien, on lui reproche parfois son nombrilisme, et l'on n'a pas complètement tort. Mais voilà, un nombril peut parfois, pourvu qu'il soit bien observé, nous apprendre beaucoup.
Les films d'Antonioni prêtent le flanc aux accusations d'élitisme un peu comme s'ils venaient d'un homme qu'on estime mais à la réputation ésotérique. Il y a dix ans déjà, présentant les cinq géants du cinéma italien d'après guerre, j'avais pris pour incipit: Rossellini le professeur éclairé, De Sica le médecin prévenant, Fellini le roi-bouffon, Visconti le cousin aristocrate et contradictoire et Antiononi un autre cousin, intellectuel un peu éloigné.
Il faudra que j'aille à Ferrare un jour. Ferrare, héroïne des si beaux livres de Giorgio Bassani mais aussi ville natale d'Antonioni . L'expo n'oublie pas ses débuts néoréalistes, le court métrage Les gens du Pô, cette Italie juste après guerre qui initiait un nouveau courant, celui d'un cinéma qui sera comme aucun autre en totale adéquation avec un pays, un peuple, une époque. Je rabâche. L'influence du Duc de Modrone, Luchino Visconti, est bien là dans le premier quart de sa carrière, dont surtout après une incursion dans les coulisses du Septième Art, La dame sans camélias et sa première muse, Lucia Bose, il s'affranchira pour défricher une terra incognita en cinéma, la fameuse incommunabilité qui devait le poursuivre toute sa vie. Très bien initiée par Le cri, avec quelques séquelles néoréalistes, cette période culmina avec sa trilogie L'Avventura, La notte, L'eclisse. Ce fut aussi l'incompréhension, y compris d'une partie de la critique dérangée dans ses certitudes.
Lettres, manuscrits, photos, et les magnifiques affiches, toutes plus belles les unes que les autres, composent ce chemin d'étoiles, interrogeant nos souvenirs cinéphiles et existentiels. Bien trop jeune pour la trilogie, j'ai découvert ces films et leur richesse trente ans après, stupéfait devant une telle modernité, un tel cran, qui devaient laisser au début des sixties bien des spectateurs au bord de la route. Un visage illumina ces années, Monica Vitti, même si dans La notte Jeanne Moreau, si souvent insupportable par la suite, forme avec Marcello un couple reflet, un duo miroir extaordinaire.
Cette expo s'intitule Aux origines du pop car Michelangelo Antonioni, très intéressé par la culture pop, Carnaby Street, le pop art, et la musique émergente, choisit de quitter l'Italie pour mijoter en Angleterre Blow up, Palme d'Or, parabole sur le voyeurisme et sur la presse qu'on n'appelait pas encore people, qui fit de lui une icône d'une certaine jeunesse, l'un des rares cinéastes à s'aventurer dans cet univers étrange et un peu effrayant pour qui avait dépassé trente ans. Moi j'en avais seize et, fou de cette musique, je retenais surtout la scène où Jeff Beck cassait sa guitare au sein des Yardbirds (Beck et Jimmy Page réunis, c'est le seul document).
Puis ce fut l'Amérique de Zabriskie Point et Profession reporter, visions désespérées des seventies, déjà évoquées sur ce blog. Mais je ne vais pas faire l'analyse exhaustive de Aux origines du pop, j'engage seulement ceux qui en auront l'occasion, à s'attarder rue de Bercy pour découvrir un artiste protéiforme et qui ne se retourna pas, le contraire d'un créateur de recettes, et qui fut aussi peintre et photographe, l'influence d'un Giorgio de Chirico notamment.
Il faudra que j'aille à Ferrare un jour. Car Michelangelo Antonioni n' apas usurpé son prénom, participant à une nouvelle renaissance de ce cinéma italien phenix, des paysans de la plaine du Pô aux esthètes oisifs romains, du Swinging London à la Chine postmaoïste. Il ya comme ça, des choses qu'il faut faire. Autre chose qu'on peut faire, sans être un italocinémaniaque comme moi, regarder ce beau montage travelling proposé par la Cinémathèque. http://www.cinematheque.fr/expositions-virtuelles/antonioni/index.htm
P.S. Pour retrouver quelques-unes de mes chroniques sur les films de M.A. tapez Antonioni dans "Rechercher".












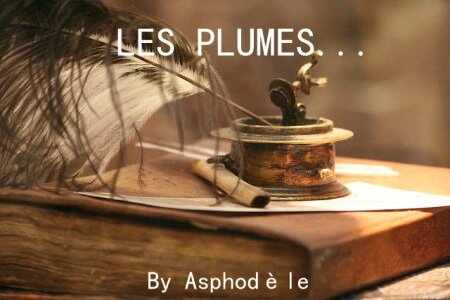
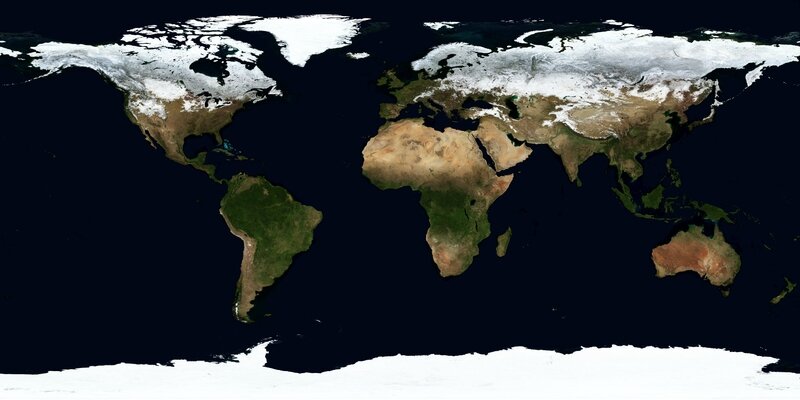



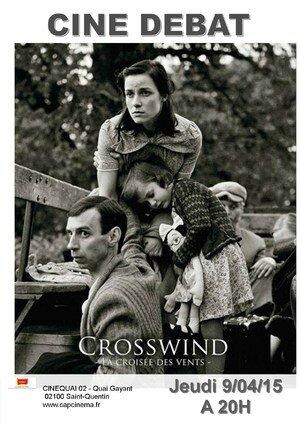













/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F6%2F167745.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F26%2F98%2F197624%2F92964159_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F30%2F44%2F197624%2F89898499_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F90%2F21%2F197624%2F73138417_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F13%2F197624%2F72893683_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F95%2F34%2F197624%2F48126630_o.jpeg)