Salut la Compagnie
Je n'avais jamais entendu parler de ce livre, paru en 1933 en Amérique. Je m'empresse de dire qu'il devrait rejoindre les grands classiques de la Der des Der, les Français Barbusse, Genevoix, Chevallier, Dorgelès, les Allemands Junger, Remarque, l'Anglo-australien Manning, l'Italien Lussu et tous les autres. La compagnie K, c'est 113 hommes. Et dans ce court bouquin ils racontent tour à tour un moment de leur vie au front. Deux pages maximum pour chacun, beaucoup de "simples" soldats, quelques sous-officiers et et quelques officiers sous les ordres d'un capitaine. C'est tout. Ni fioritures ni envolées lyriques. Des faits.
Compagnie K, c'est le Bois Belleau, dans le sud de mon département, c'est l'Argonne, c'est cette Picardie et cette Champagne, des roses et du breuvage d'or. Je l'ai écrit mille fois, je suis d'une terre de cimetières et d'obus. Bien des Américains reposent là-bas. Mais William March, qui fut l'un de ces deux millions d'Américains qui traversèrent l'Atlantique, reste à hauteur d'homme, c'est des fois pas très haut, la hauteur d'homme, chroniquant en quelques dizaines de lignes des scènes précises et acérées. Nobles quelquefois, immondes aussi, humaines plus simplement.
Parfois carrément cocasses (le soldat Martin Passy évoquant une diseuse de bonne aventure qui lui porta chance, les sautes d'humeur de Mamie la mule de la roulante), les billets prodiguent souvent une émotion brute, brutale, un peu comme un K.O. en quelques dizaines de secondes. La mort, c'est parfois expéditif et William March vous laisse un peu groggy. Ces "nouvelles" de la guerre, sur la guerre et parfois l'après-guerre, sonnent toutes comme des rappels, des injonctions, sur les multiples traumatismes du conflit mondial. Ici un officier exécute sommairement des prisonniers, là une gueule cassée voit sa promise craquer au moment ultime "Si tu me touches je vomis". La construction précaire d'un ponton, quelques mots d'un aumônier, un soldat américain vole la médaille du fils, mort au front, du couple qui l'a accueilli. Pas toujours sublime, litote.
Les petitesses de l'âme humaine accompagnent les grandeurs discrètes au long de ces témoignages tout sauf grandiloquents. Tous les textes sont bouleversants, et je le répète, l'humour cotoie le désespoir. Marchant dans la campage picarde je songerai encore davantage aux gens de toutes sortes et sous tous drapeaux, couchés en cette terre de douleur.









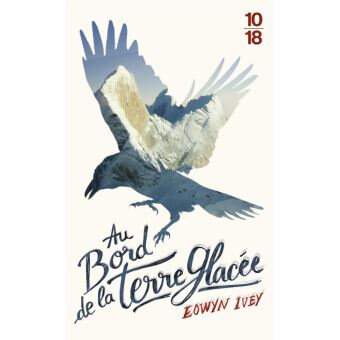








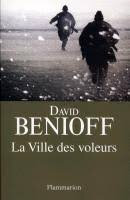




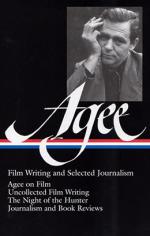




/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F6%2F167745.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F26%2F98%2F197624%2F92964159_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F30%2F44%2F197624%2F89898499_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F90%2F21%2F197624%2F73138417_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F13%2F197624%2F72893683_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F95%2F34%2F197624%2F48126630_o.jpeg)