
Dans le plutôt bon roman irlandais que je viens de terminer, et nous en reparlerons très vite, il y a une scène où un père initie son fils à la traditionnelle épreuve des ricochets sur le lac ou la rivière. Le même jour une de mes blogueuses préférées nous présentait une charmante petite nouvelle dans le grand charivari de notre monde, au prénom de devineresse. Alors voilà. A priori aucun rapport. Sauf que si.
La scène du livre irlandais dont je vous entretiens a réveillé en moi (elle dormait que d'un oeil, à peine) l'image de ma rivière à moi. On a tous quelque chose en nous d'une rivière. Ma Tennessee, à moi, mon Rhône, ma Volga, s'appelle l'Oise. Et croyez-moi elle en vaut bien d'autres. Et elle, au moins, ne dégénère pas comme ces monstres, Amazone, Nil, Mississippi. Rassurez-vous, un peu tératophile, j'aime aussi les monstres. Moi-même à l'occasion...Enfin on me l'a dit. J'ai habité mes vingt premières années à quinze mètres des rives de cet affluent de la Seine. Et les péniches sillonnaient son cours, d'abord tirées par les ultimes remorqueurs, car je ne suis pas d'âge tout à fait à évoquer les chevaux sur les chemins de halage. Remplacées maintenant par quelques modestes plaisanciers au lent cours.
A la maison nous n'étions pas pêcheurs, nous étions regardeurs. Très jeune j'arpentais les bords de ma rivière, pourtant bien peu sécurisée si ce n'est par une bouée dans un coffrage, et pas si fréquente, la bouée. Souvenirs de pneumatiques dans le courant, d'où nous sortions la tête en nous esclaffant. Parfois y avait même deux ou trois filles mais je ne leur parlais pas. Elles me faisaient peur déjà. Mais on sait bien que la peur fascine.

Avant ces épisodes de ma vie aquatique mon père, qui comme tout le monde ignorait la natation, était pourtant champion. Sur ces bords de l'Oise, tout en saules se lamentant sur l'onde, et en ressacs mariniers clapotant, il était expert, d'abord dans le ramassage des projectiles. A l'époque, les rives, moins muraillées, laissaient quelque accès à des bouts de plages, et à des pierres plates, parfois segments d'ardoises, l'idéal du lanceur. Qui dira le geste auguste du papa jeteur de cailloux dans le fleuve? Qui dira l'ébahissement du gamin devant cette merveille de la physique des liquides? La vérité de la vie n'a pas fait de moi une star du rebond isarien. Là je vois dans vos yeux de rhôdanien, de séquanais ou de rhénan que vous ignorez l'adjectif isarien. Tout comme moi jusqu'à peu. Il ramassait une galette, soufflait dessus. Il soufflait aussi, sur Les trois mousquetaires, je me souviens, la première fois qu'il m'avait tendu l'exemplaire ancien, mais soigné, et qui devait tant compter.
Ca se passait en début de soirée, quand le flux batelier avait cessé, que les nefs étaient amarrées juste devant chez nous et qu'aucun remous motorisé ne perturbait l'art de jeter des pierres et de faire des ronds dans l'eau. Mon père était l'artiste, six ou sept sauts du caillou magique. Moi j'étais l'arpette, l'innocent, le cancre. Au moins sur ce plan (d'eau) là, je le suis resté. Si son ambition était de faire de moi un lanceur hors pair, il a échoué, Alfred. Mon père s'appelait Alfred. Si son ambition état de faire de moi un lecteur il a plutôt réussi.






















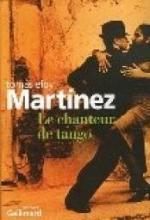
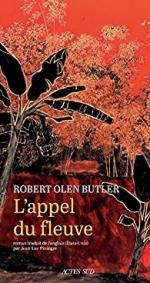






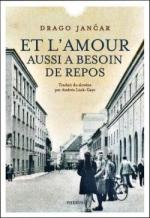
/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F6%2F167745.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F26%2F98%2F197624%2F92964159_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F30%2F44%2F197624%2F89898499_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F90%2F21%2F197624%2F73138417_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F13%2F197624%2F72893683_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F95%2F34%2F197624%2F48126630_o.jpeg)