Dans la cité des anges
Lecture commune avec ma chère Val, toujours prête à collaborer (La grâce des brigands – Véronique Ovaldé). Ce fut son choix cette fois et elle a bien fait de me présenter une auteure dont j'ai souvent vu les livres de ci de là, mais jamais rien lu. Il y a une certaine grâce chez les perdants, les plagiaires et les brigands. Je vous dévoile ainsi l'ultime sentence de ce roman. Il a beaucoup de charme. Véronique Ovaldé nous emmène en Californie dans les pas de Maria Cristina, devenue écrivaine après sa rupture avec mère et soeur. D'origine finlandaise elle a quitté l'improbable bled de Lapérouse, Canada à l'âge de 17 ans. Dans la tentaculaire Los Angeles elle fait vite la connaissance de Claramunt, écrivain qui n'écrit plus guère, nobelisable, enfin dit-il. Devenue sa secrétaire en attendant mieux elle cherche à lui faire lire ses propres textes.
Maria Cristina est une héroïne originale à mon sens. Car devenue assez célèbre elle n'est jamais dupe des faux semblants particulièrement prospères en Californie. Il n'y a pas dans La grâce des brigands une réelle unité fictionnellle qui permettrait un chemin assez balisé et on ne sait pas très bien où on va. C'est pas plus mal comme ça et c'est parfois surprenant, surprenant comme le pseudo d'un chauffeur au nom imprononçable, Oz Mithzaverzbki. Alors on l'appelle...Judy Garland. C'est un roman qui parvient à nous étonner, un regard français sur les mirages de la gloire. Comme un miroir aux alouettes, sans la naïveté qu'ont parfois les héroïnes de ces histoires. Parfois un peu désarçonné, j'ai cependant suivi avec plaisir cette Maria Cristina, pas vraiment sortie de la cuisse de Jupiter, mais qui va son chemin vaillamment jusqu'à une conclusion qui ménage la surprise, ce qui n'est pas si fréquent dans l'art du roman.
Je conseille vivement ce California dreamin' qui parvient à éviter pas mal de clichés sur cette Babylone contemporaine, un prisme français, louvoyant comme dans une baie pacifique, nous permet vraiment de belles envolées.




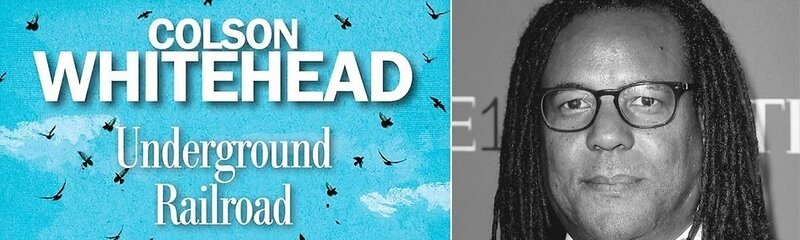




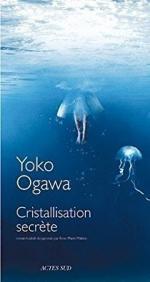

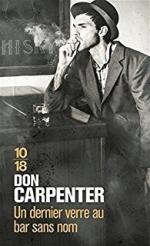

















/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F6%2F167745.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F26%2F98%2F197624%2F92964159_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F30%2F44%2F197624%2F89898499_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F90%2F21%2F197624%2F73138417_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F13%2F197624%2F72893683_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F95%2F34%2F197624%2F48126630_o.jpeg)