Art et Essai
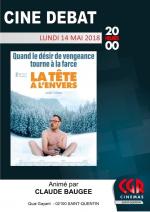 Ne négligeons pas les derniers films dits d'auteur de la saison 17-18 et revenons sur les difficultés à intéresser un plus large public dans une ville moyenne. Le challenge est assez passionnant mais semé d'embûches et de désillusions. L'âge relativement mûr des fidèles de l'Art et Essai, c'est comme ça que ça s'appelle, même si je récuse ce terme, n'est certes pas très encourageant quant au renouvellement des cadres. Je suis aussi très circonspect quant à l'absence remarquée des enseignants dont on pourrait attendre un peu plus de soutien. J'entends bien que les actifs, dont je ne suis plus, peuvent avoir d'autres priorités. Mais sans être là à chaque fois une présence un peu plus marquée serait la bienvenue.
Ne négligeons pas les derniers films dits d'auteur de la saison 17-18 et revenons sur les difficultés à intéresser un plus large public dans une ville moyenne. Le challenge est assez passionnant mais semé d'embûches et de désillusions. L'âge relativement mûr des fidèles de l'Art et Essai, c'est comme ça que ça s'appelle, même si je récuse ce terme, n'est certes pas très encourageant quant au renouvellement des cadres. Je suis aussi très circonspect quant à l'absence remarquée des enseignants dont on pourrait attendre un peu plus de soutien. J'entends bien que les actifs, dont je ne suis plus, peuvent avoir d'autres priorités. Mais sans être là à chaque fois une présence un peu plus marquée serait la bienvenue.
La tête à l'envers a été bien reçu, comédie un peu noire de l'Autrichien Josef Hader sur la mise à l'écart d'un critique musical viennois. Teinté de pas mal de cynisme le parcours du personnage vire àl'obsession, à l'infantilisme, à la férocité gratuite. Ca reste de l'ordre de la drôlerie, à la limite du drame social de la mise au placard. Hader, célèbre en Autriche pour ses one man shows, ne franchit pas cette borne. Rappelons qu'il fut il y deux ans un remarquable Stefan Zweig, l'adieu à l'Europe.
 Nous avions projeté il y a deux ans Les chansons que mes frères m'ont apprises le premier film de la sino-américaine Chloé Zhao. Dans The rider elle décrit la vie difficile d'un jeune Amérindien, Brady, as du rodéo, qu'une chute de cheval a interdit de compétition. Elle y décrit aussi toute la précarité de la condition de ces indiens du Dakota. Brady Jandreau et sa famille jouent leur propres rôles. C'est d'ailleurs son histoire à peine romancée. The rider est ainsi à la limite du documentaire. On comprend que Chloé Zhao, comme dans son premier film, s'interroge sur la place de l'indien au XXIème siècle. Laveurs de carreaux au sommet des gratte-ciel ou cavaliers cherchant à vivre leur passion et de leur passion, il n'est pas si facile d'être un native au coeur de l'Amérique. Apprécié du public qui supporte toujours mal l'euthanasie équine inhérente au milieu.
Nous avions projeté il y a deux ans Les chansons que mes frères m'ont apprises le premier film de la sino-américaine Chloé Zhao. Dans The rider elle décrit la vie difficile d'un jeune Amérindien, Brady, as du rodéo, qu'une chute de cheval a interdit de compétition. Elle y décrit aussi toute la précarité de la condition de ces indiens du Dakota. Brady Jandreau et sa famille jouent leur propres rôles. C'est d'ailleurs son histoire à peine romancée. The rider est ainsi à la limite du documentaire. On comprend que Chloé Zhao, comme dans son premier film, s'interroge sur la place de l'indien au XXIème siècle. Laveurs de carreaux au sommet des gratte-ciel ou cavaliers cherchant à vivre leur passion et de leur passion, il n'est pas si facile d'être un native au coeur de l'Amérique. Apprécié du public qui supporte toujours mal l'euthanasie équine inhérente au milieu.
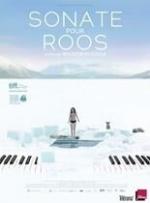 Beau film que Sonate pour Roos du cinéaste néerlandais Boudewijn Koole, qui pâtit un peu de l'ombre écrasante, jusqu'au titre français, de Bergman. On l'a bien vu lors des réactions du public. Comment faire autrement quand l'action se passe dans une Norvège profonde, toute en neige et en relations mère-fille très difficiles. Ajouter à cela une révélation et vous avez toute latitude à penser aux films du grand maître. Il ne faut pas. Il faut apprécier dans Sonate pour Roos l'art de mettre en valeur les sons. Bengt, le jeune frère de Roos est passionné d'enregistrements. Et l'on entend le bruit de l'eau qui ruisselle, la glace qui craque, les pas sur la neige, composant avec le piano original un joli concerto en blanc majeur.
Beau film que Sonate pour Roos du cinéaste néerlandais Boudewijn Koole, qui pâtit un peu de l'ombre écrasante, jusqu'au titre français, de Bergman. On l'a bien vu lors des réactions du public. Comment faire autrement quand l'action se passe dans une Norvège profonde, toute en neige et en relations mère-fille très difficiles. Ajouter à cela une révélation et vous avez toute latitude à penser aux films du grand maître. Il ne faut pas. Il faut apprécier dans Sonate pour Roos l'art de mettre en valeur les sons. Bengt, le jeune frère de Roos est passionné d'enregistrements. Et l'on entend le bruit de l'eau qui ruisselle, la glace qui craque, les pas sur la neige, composant avec le piano original un joli concerto en blanc majeur.
Les rapports si tendus entre Roos et sa mère sont souvent faits de silences et de non-dits, sans rage véritable, et c'est d'autant plus impressionnant. Certes austère, parfois lumineux, les jeux de Bengt et de Roos, sur fond de manque de ciel et d'horizon, oppressant, sensuel et douloureux, Sonate pour Roos a convaincu la majorité des spectateurs. Réconfortant à l'heure où l'on peut douter d'une action cinéphile efficace.
 Ce sera plutôt pour moi la révolution paresseuse. Mon ami Martin a dit l'essentiel sur le très utile film allemand de Lars Kraüme La révolution silencieuse. Je le rejoins complètement. Ca s'appelle Se taire et résister et je ne résiste pas à me taire pour vous inviter à lire son billet.
Ce sera plutôt pour moi la révolution paresseuse. Mon ami Martin a dit l'essentiel sur le très utile film allemand de Lars Kraüme La révolution silencieuse. Je le rejoins complètement. Ca s'appelle Se taire et résister et je ne résiste pas à me taire pour vous inviter à lire son billet.



/image%2F1209912%2F20240227%2Fob_037345_mann.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F65%2F41%2F197624%2F134012569_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F73%2F64%2F197624%2F133812607_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F91%2F57%2F197624%2F133635244_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F6%2F167745.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F26%2F98%2F197624%2F92964159_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F30%2F44%2F197624%2F89898499_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F90%2F21%2F197624%2F73138417_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F13%2F197624%2F72893683_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F95%2F34%2F197624%2F48126630_o.jpeg)