Brûler les planches
J'ai lu presque tout Joseph O'Connor, nouvelles ou romans. Plusieurs ont été chroniqués ici. Et je n'ai pas été déçu cette fois encore. Comme dans Muse l'auteur irlandais mêle une relation de fiction à la vie de trois célébrités, Bram Stoker, immortel auteur de Dracula et deux gloires britanniques du théâtre de la fin du XIXème siècle, Henry Irving et Ellen Terry, souvent comparée à Sarah Bernhardt. O'Connor est expert en grand romanesque et s'y entend pour les retours sur le passé, mais aussi la forme épistolaire et le journal pour nous entraîner dans l'inimité de ce trio qui brûle les planches de ces scènes londoniennes puis du monde entier. Où rôdent Dorian Gray, ce qui reste acceptable, mais aussi Jack l'Etrangleur, ce qui l'est moins.
Si Henry Irving et Ellen Terry connaissent une renommée internationale, Bram Stoker, lui, restera dans l'ombre toute sa vie. Ce n'est que plus tard notamment grace au cinéma qu'il triomphera bien que, comme souvent, sa créature soit devenue plus célèbre que lui-même. Tous trois se rencontrent au Lyceum Theater dont Stoker deviendra le régisseur. Comme toujours, de sa plume chatoyante et souvent enjouée, O'Connor excelle à nous faire vivre dans l'air du temps. En l'occurrence cette Angleterre victorienne si propice aux intrigues en coulisses et aux triomphes scéniques.
La genèse très laborieuse de Dracula parsème le récit régulièrement au gré des hauts et des bas de Bram Stoker, souvent rudoyé, voire humilié par le cabotin shakespearien génial Henry Irving. L'amitié survit malgré tout et Ellen Terry de toute sa grace illumine volontiers le trio. On sourit souvent à la truculence du récit qui court sur les trois carrières des protagonistes. George Bernard Shaw, par exemple, en prend pour son grade, jalousie des théâtreux. Joseph O'Connor est aussi à l'aise que lorsqu'il explore la poésie dans Muse, le monde du rock dans Maintenant ou jamais, l'immigration dans L'Etoile des Mers. Mais tous ses livres sont formidables même si mon irlandophilie frise le déraisonnable.
Irving, parlant de Stoker: C'est un petit gratte-papier irlandais, Ellen. Il ne sera jamais rien d'autre. Ces prétentions à produire de la soi-disant littérature, c'est la malédiction des gens de son pays, je n'en ai jamais rencontré un seul qui ne se prenne pour un fichu poète, comme tous les autres sauvages à la surface de cette terre.
Dialogue Irving-Stoker: Et quel est donc le thème de ta dernière efflorescence artistique? - C'est une histoire de vampire. - Que Dieu nous garde. - En quoi cela pose-t-il des difficultés. - Les vampires ont été usés jusqu'au sang, si je puis dire - Il ya là ce que j'espère être un rôle majeur pour un acteur. Accepterais-tu de le lire? - Tu imagines Sir Henry Irving jouant un croquemitaine dans un spectacle de grand-guignol? Je ne crois pas, mon chéri.











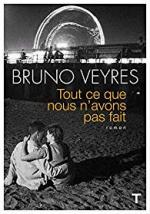















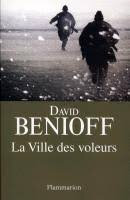



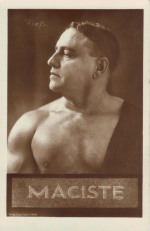



/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F6%2F167745.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F26%2F98%2F197624%2F92964159_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F30%2F44%2F197624%2F89898499_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F90%2F21%2F197624%2F73138417_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F13%2F197624%2F72893683_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F95%2F34%2F197624%2F48126630_o.jpeg)