Mots luxes
Un très beau roman, qu'on dira souvent roman d'adolescence, d'initiation, mixte de L'île au trésor et de L'attrape-coeurs. Mais surtout fascinante incursion dans l'univers d'un préado de 13 ans, Miles O'Malley, qui vit à Olympia, extrême Ouest américain, modeste capitale du Washington, sur les bords du Pacifique, ou plus exactement du Puget Sound, bras de mer qui s'infiltre vers le continent. Cette zone est réputée pour sa faune de mollusques et de crustacés. Et Jim Lynch parvient à nous intéresser à l'ahurissante existence de ces curieuses bestioles. Sûr que l'on en apprend de belles sur les hôtes de ce rivage à nul autre pareil. Et c'est déjà une vraie joie de faire connaissance avec le panope, plus gros mollusque du monde, plusieurs kilos et une trompe de près d'un mètre (évidemment annexé comme aphrodisiaque en Asie). Connaissez-vous les dollars de sable (cousins des oursins) et les serpules ( vers ou fleurs, on ne sait pas trop)? Tout cela est d'une verve poétique inattendue. Et le savoir n'est jamais asséné mais distillé comme un doux ressac sur une plage nord-californienne
Mais ces côtes pacifiques ne le sont pas toujours et Miles, avec ses découvertes de monstres marins inhabituels, mais c'est le propre de cette microrégion que de receler des curiosités, va se trouver malgré lui au centre d'une polémique, tel un gourou annonciateur d'apocalypse. déferlent sur les plages des touristes, des scientifiques plus ou moins sérieux, l'inévitable secte catastrophiste, et bien sûr des journalistes. Miles, qui peine à grandir, et son copain Phelps, évidemment une grande asperge, continuent d'arpenter les rivages et de filer à vélo pour recueillir des échantillons grouillants de la vie marine et sous-marine locale. Quoi que travaillé sur le plan hormonal notamment par les seins de sa voisine Angie, d'une vingtaine d'années, accessoirement fille de juge et bassiste vaguement hard rock, Miles en est encore à s'étonner de la présence de certains types de méduses. "Les cinq vélelles connurent un succès instantané. Les puissants vents d'ouest rejetaient fréquemment des milliers de vélelles sur les côtes sablonneuses de l'état du Washington. Sauf que ces petites méduses-qui ressemblent à des spinnakers de voiliers miniatures-avaient visiblement traversé le Paicgique et vogué jusqu'à l'entrée de Skookumchuck Bay, ce qui en faisait des championnes de la navigation."
Je l'ai dit plus haut. Je l'ai dit plus haut. Il y a du Jim Hawkins et du Holden Caulfield dans ce gamin de Miles O'Malley. Mais les prestigieux parrainages de Stevenson et Salinger ne doivent pas impressionner ni faire craindre trop de redites. Jim Lynch a su créer un très beau monde original avec des relents d'originel, comme une aube d'humanité, ode à la vie marine et à la vie tout court. A travers Miles et croisant le fer face aux incertitudes de la pollution et aux préjugés tenaces on se prend à espérer de beaux jours sur ces rives pacifiques nord. Et de belles heures à lire Les grandes marées (Gallmeister), premier roman de Jim Lynch, que quelques-uns ont peut-être déjà lu sous le titre A marée basse (Editions des Deux Terres, 2008).








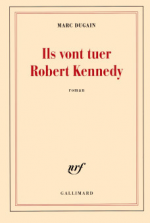

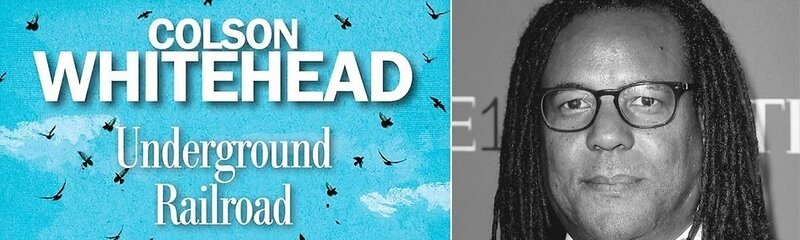
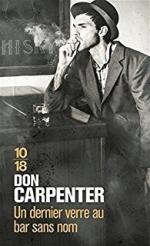





![Red%20Desert_image02[1]](https://storage.canalblog.com/88/43/197624/115684213.jpg)















/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F6%2F167745.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F26%2F98%2F197624%2F92964159_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F30%2F44%2F197624%2F89898499_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F90%2F21%2F197624%2F73138417_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F13%2F197624%2F72893683_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F95%2F34%2F197624%2F48126630_o.jpeg)