 A propos de guerre, de novembre et de deuil (j'aime tout spécialement "une abeille de cuivre chaud").
A propos de guerre, de novembre et de deuil (j'aime tout spécialement "une abeille de cuivre chaud").
L’Evadé
Il a dévalé la colline
Ses pas faisaient rouler les pierres
Là-haut entre les quatre murs
La sirène chantait sans joie
Il respirait l’odeur des arbres
Avec son corps comme une forge
La lumière l’accompagnait
Et lui faisait danser son ombre
Pourvu qu’ils me laissent le temps
Il sautait à travers les herbes
Il a cueilli deux feuilles jaunes
Gorgées de sève et de soleil
Les canons d’acier bleu crachaient
De courtes flammes de feu sec
Pourvu qu’ils me laissent le temps
Il est arrivé près de l’eau
Il y a plongé son visage
Il riait de joie il a bu
Pourvu qu’ils me laissent le temps
Il s’est relevé pour sauter
Pourvu qu’ils me laissent le temps
Une abeille de cuivre chaud
L’a foudroyé sur l’autre rive
Le sang et l’eau se sont mêlés
Il avait eu le temps de voir
Le temps de boire à ce ruisseau
Le temps de porter à sa bouche
Deux feuilles gorgées de soleil
Le temps d’atteindre l’autre rive
Le temps de rire aux assassins
Le temps de courir vers la femme
Il avait eu le temps de vivre.
Boris Vian, Chansons et Poèmes












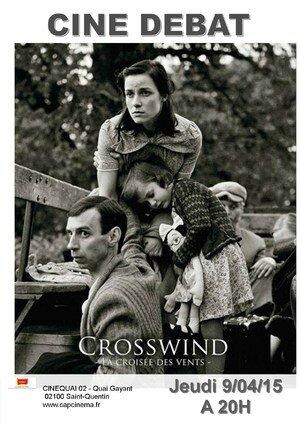

















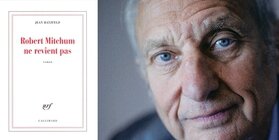




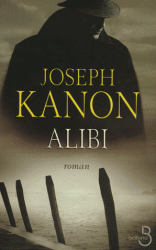
/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F6%2F167745.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F26%2F98%2F197624%2F92964159_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F30%2F44%2F197624%2F89898499_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F90%2F21%2F197624%2F73138417_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F13%2F197624%2F72893683_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F95%2F34%2F197624%2F48126630_o.jpeg)